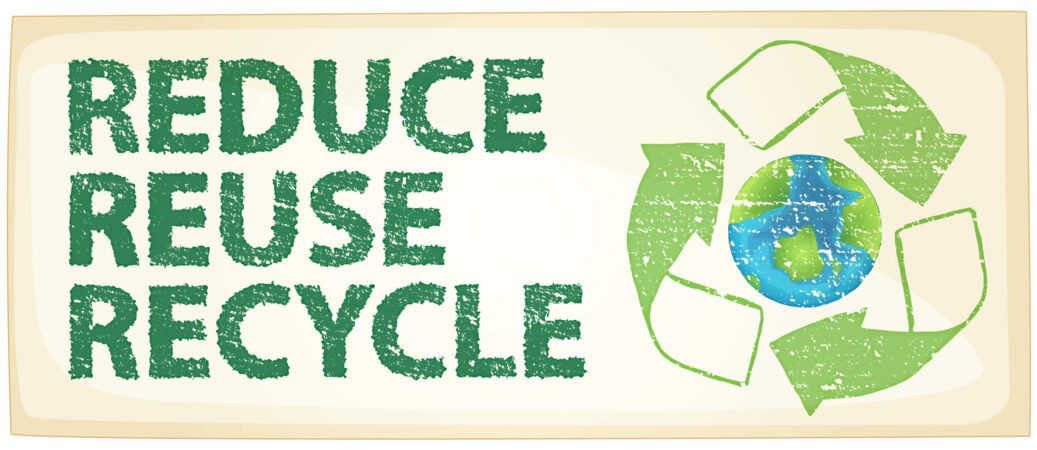Réemploi : définition, enjeux et leviers pour une économie plus durable
Longtemps éclipsé par l’essor du jetable et de la surconsommation, le réemploi revient aujourd’hui sur le devant de la scène. Pour cause, il permet de réduire les impacts environnementaux, prolonger la durée de vie des objets, réduire notre production de déchets et construire une économie plus sobre, circulaire et résiliente. Mais si on entend son nom partout, cela ne veut pas pour autant dire qu’on en saisit le sens. Cet article a pour vocation de lever toute ambiguïté. Quelle est la définition du réemploi ? En quoi se différencie-t-il de la réutilisation ou du recyclage ? Quels sont ses bénéfices écologiques, économiques et sociaux ? Qui sont les acteurs qui le rendent possible ? Autant de questions essentielles qui trouvent leur réponse ici.
Qu’est-ce que le réemploi ?
Réemploi def
Le réemploi est défini par l’ADEME comme « l’opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori, lui donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit et ne devient à aucun moment un déchet. Il s’agit d’une composante de la prévention des déchets. »
Autrement dit, le réemploi consiste à prolonger l’usage d’un produit sans le transformer, ni le considérer comme un déchet. Il s’inscrit pleinement dans une logique de développement durable : celle qui privilégie la réparation, le don, la vente ou la réaffectation directe d’un bien en état de fonctionnement.
Sur le plan réglementaire, cette distinction est cruciale : un produit réemployé n’entre pas dans le circuit du traitement des déchets. Il n’est donc pas soumis aux mêmes obligations que les matériaux destinés à la valorisation ou à l’élimination. Cela en fait un levier stratégique de prévention, au cœur des politiques de réduction du gaspillage.
Différence entre réemploi, réutilisation et recyclage
Dans le langage courant, les notions de réemploi, de réutilisation et de recyclage sont souvent utilisées comme synonymes. Pourtant, si ces différentes approches de valorisation s’inscrivent toutes dans une démarche d’économie circulaire, elles répondent à des processus et des impacts environnementaux bien distincts.
Réemploi définition
Le réemploi consiste à utiliser à nouveau un produit pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Autrement dit, il s’agit de le réemployer tel quel (ou après une modification mineure), sans modification de son usage initial. Il s’inscrit dans une démarche de prévention des déchets.
Exemples :
- une chaise de bureau récupérée et remise en vente par une ressourcerie
- un téléphone fonctionnel donné à un proche
- des verres consignés réutilisés dans un festival
Réutilisation définition
La réutilisation concerne des objets devenus déchets, mais qui peuvent être adaptés ou réparés pour un usage différent de leur fonction initiale. C’est ce que le Code de l’environnement appelle la « préparation en vue de la réutilisation« , soit une opération de contrôle, nettoyage ou réparation afin de remettre un matériel en état de marche.
Exemples :
- un vieux drap transformé en chiffon de nettoyage
- un meuble cassé utilisé pour en faire un banc d’entrée
- des pots de confiture vides transformés en contenants de rangement
Recyclage définition
Le recyclage intervient, lui aussi, une fois le produit devenu déchet. Il s’agit alors de traiter ce dernier afin d’en extraire des matières premières secondaires, puis de les transformer afin de créer de nouveaux produits de même usage ou d’usage différent. Ce mode de traitement vise à donner une nouvelle vie aux biens en fin d’utilisation.
Exemples :
- une bouteille plastique broyée pour produire du textile synthétique
- un vieux smartphone désossé pour en récupérer les métaux rares
- des gravats de chantier transformés en matériaux de remblai
Pour aller plus loin, découvrez notre article « Quelle différence entre réemploi, recyclage et réutilisation » ?
Quel est le cadre légal et réglementaire ?
En France
Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire
La loi AGEC du 10 février 2020 vise à changer le modèle de production et de consommation actuel dans le but de limiter la production de déchets et de préserver l’environnement. L’objectif ? Passer d’une économie linéaire à une économie circulaire et accélérer la transition écologique.
Pour ce faire, 5 axes d’actions ont été déterminés :
- Sortir du plastique jetable : fin de mise sur le marché de plastique à usage unique d’ici 2040, avec une limitation de la production progressive.
- Mieux informer : mesures pour faciliter le tri, meilleure transparence sur la présence de perturbateurs endocriniens dans certains produits, mise en avant de l’impact de l’utilisation d’Internet en effet de serre…
- Lutter contre le gaspillage et promouvoir le réemploi : interdiction de détruire les invendus non-alimentaires (favoriser plutôt le don et le recyclage), réduction de 50 % du gaspillage alimentaire, création de fonds de réemploi, allongement de la durée de vie des produits…
- Lutter contre l’obsolescence programmée : mise en place d’un indice de réparabilité et de durabilité afin de faciliter la réparation.
- Mieux produire : étendre la responsabilité des industriels dans la gestion des déchets, optimiser la gestion des déchets dans le secteur du bâtiment, mettre en place un bonus-malus sur l’utilisation de certains produits…
Article L541-1 du Code de l’environnement
Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement afin d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030.
L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010
L’ordonnance relative aux déchets transpose et confirme la priorité donnée à la prévention par la réduction de la production et de la nocivité des déchets dans la réglementation française. Le réemploi faisant partie intégrante de la prévention des déchets, cette opération de transposition renforce son cadre légal.
En Europe
Directive cadre 2008/98/CE
La directive cadre européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 hiérarchise les modes de gestion des déchets à privilégier avec la priorité donnée à la prévention des déchets. Le réemploi doit ainsi être privilégié, devant le recyclage et devant la valorisation énergétique.
L’article 3 de la directive définit également les termes de réemploi et de préparation en vue du réemploi. Cette directive s’accompagne régulièrement d’appels à projets pour soutenir les initiatives innovantes en matière de réemploi.
Élargissement du plan d’action pour une économie circulaire de mars 2022
Mise en place de nouvelles règles visant à rendre plus écologique la quasi-totalité des biens physiques sur le marché européen. Cela implique la :
- Création d’un passeport numérique et de classes de performances (A à G) pour permettre une meilleure traçabilité et transparence auprès des consommateurs, notamment concernant la disponibilité des pièces détachées
- Création d’un indice de réparabilité
- Obligations d’achat responsable pour les acheteurs publics
- Interdiction de détruire les invendus
Pourquoi faire du réemploi aujourd’hui ?
Réduction de l’impact environnemental
Le réemploi permet de prolonger la durée de vie des produits, réduisant ainsi le besoin de produire de nouveaux biens. Cela entraîne donc une diminution de l’empreinte écologique, des économies de ressources naturelles (matières premières, eau, énergie) et une limitation des émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication et au transport. En donnant une seconde vie aux objets, vous contribuez également à réduire la quantité de déchets envoyés en décharge ou en incinération.
Les avantages résumés :
- Prolonger de la durée de vie des produits
- Diminuer l’empreinte écologique
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre
- Préserver les ressources naturelles
- Réduire la production de déchets
Avantages économiques pour les entreprises
Espace de stockage inutilisé ou sous-exploité, dépréciation des matériaux qui perdent de la valeur avec le temps, coûts élevés de traitement des déchets lorsque les matériaux deviennent obsolètes…Le réemploi permet de réduire les coûts de stockage et les frais de gestion des déchets.
Par ailleurs, le réemploi permet de réduire le coût de production et les dépenses liées aux achats de matériel neuf. Enfin, il peut favoriser la création d’une nouvelle source de revenus avec la revente de matériaux dormants à d’autres entités. Avec MyTroc Pro, on estime à 40 266 588 € d’économie sur les achats et de revenus générés par nos clients.
Les avantages résumés :
- Moins de coûts de stockage et de gestion des déchets
- Économies sur les achats de matériel neuf
- Développement d’une nouvelle source de revenus
Bénéfices sociaux et territoriaux
Le réemploi joue un rôle important dans l’inclusion sociale et professionnelle, notamment via des structures comme les ressourceries ou les entreprises d’insertion. C’est aussi un puissant outil de sensibilisation à la consommation responsable et de valorisation des savoir-faire locaux, contribuant à la dynamisation des territoires.
Les avantages résumés :
- Sensibilisation à la consommation responsable
- Développement de l’emploi et de l’insertion sociale
Avantages réglementaires
Avec la loi AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire), la mise en œuvre d’une stratégie de réemploi est désormais obligatoire dans de nombreux secteurs, notamment dans le secteur du BTP. Adopter une marketplace de réemploi permet donc de vous conformer aux réglementations et normes environnementales en vigueur.
Par ailleurs, dans de nombreux pays dont la France, les entreprises adoptant des stratégies de réemploi peuvent accéder à des incitations financières, comme des réductions de taxes ou des subventions pour l’économie circulaire.
Pour aller plus loin, découvrez les 4 avantages d’une plateforme de réemploi pour votre entreprise !
Qui sont les acteurs du réemploi ?
Les entreprises
Les entreprises peuvent agir à plusieurs niveaux :
- Éco-conception : penser les produits dès leur création afin qu’ils soient réparables, démontables et compatibles avec une seconde vie.
- Logistique : organiser la collecte, le retour, le tri ou la remise en circulation des produits via des circuits courts, parfois mutualisés.
- Mise en marché : intégrer des produits reconditionnés ou réemployés dans leur offre commerciale, créer des systèmes de consigne ou de location et proposer des services de reprise.
Les collectivités territoriales
Les leviers des collectivités sont multiples :
- Soutien aux structures locales : ressourceries, ateliers de réparation, plateformes de réemploi, via des subventions ou des partenariats.
- Mise à disposition d’infrastructures : espaces dédiés dans les déchèteries (espaces réemploi), locaux pour les associations, tiers-lieux, etc.
- Intégration dans les politiques publiques : via un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) ou une stratégie d’écologie industrielle et territoriale adaptés.
Les structures spécialisées
Au plus près du terrain, des milliers de structures animent déjà la filière du réemploi :
- Ressourceries et recycleries : elles collectent, trient, testent, réparent et remettent en circulation des objets de toutes sortes (électroménager, mobilier, vêtements…).
- Associations et structures d’insertion : elles proposent des emplois à des personnes éloignées du marché du travail.
- Entreprises sociales et coopératives : elles innovent dans la logistique, la plateforme numérique ou le reconditionnement.
Les citoyens
Chaque citoyen peut être acteur du réemploi à son échelle :
- Acheter d’occasion ou via des plateformes de réemploi.
- Préférer la réparation plutôt que le neuf systématique.
- Donner ou vendre ce qu’il n’utilise plus, au lieu de jeter.
- S’informer, militer, participer à des collectifs ou des actions de sensibilisation.
L’État
L’État a pour rôle d’encadrer, inciter et structurer l’essor du réemploi :
- Cadre législatif et réglementaire : loi AGEC, responsabilité élargie des producteurs (REP), objectifs de prévention des déchets.
- Soutien financier : aides à l’investissement, financement de l’innovation sociale et environnementale, accompagnement des filières.
- Pilotage stratégique : coordination nationale, suivi des indicateurs, appui à la formation et à la sensibilisation.
Quels sont les secteurs clés du réemploi en France (+ exemples) ?
Le bâtiment et les matériaux de construction
Le secteur du BTP représente à lui seul plus de 40 millions de tonnes de déchets chaque année en France. Face à cette montagne de matière, le réemploi des matériaux de construction s’impose comme une solution majeure.
Paris Habitat, principal bailleur social de la capitale, s’est engagé dans cette démarche en lançant en 2023 la plateforme de réemploi Réflexe. Cette initiative vise à faciliter le réemploi des matériaux issus de ses chantiers de réhabilitation et de construction.
Le secteur des transports
Le secteur des transports, confronté à des défis majeurs tels que l’augmentation des coûts d’exploitation, les objectifs renforcés de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et les tensions croissantes sur les approvisionnements, trouve dans le réemploi une solution efficace. Les objectifs ? Valoriser ses ressources internes, limiter les déchets et mieux maîtriser les stocks.
Des acteurs majeurs tels que la SNCF et la RATP ont mis en place des plateformes de réemploi afin d’optimiser la circulation de leur matériel. Ces initiatives permettent non seulement de réemployer du matériel en interne, mais aussi d’ouvrir certains flux vers des partenaires externes, via un système de revente sécurisé.
Tout mobilier ou équipement professionnel
Les bureaux, collectivités, administrations et entreprises privées génèrent chaque année des tonnes de mobilier et d’équipements encore fonctionnels, remplacés uniquement pour des raisons esthétiques ou organisationnelles. De plus, la gestion des déchets a un coût pour les entreprises. Ces dépenses s’élevaient à 20.6 M€ en 2019. Préférer le réemploi permet de les diminuer. Peu importe votre secteur d’activité.
MyTroc Pro, votre solution de remploi professionnel
Pionnier et leader du réemploi en France, MyTroc Pro accompagne les grandes entreprises (industrie, BTP, énergie, santé, enseignement…) dans la création de marketplaces de réemploi en marque blanche. L’objectif ? Mutualiser les ressources internes d’une entreprise afin que les collaborateurs puissent s’échanger, se donner ou se vendre des biens.
Et ce, de manière simple. En effet, notre équipe vous accompagne de l’analyse de vos besoins à l’intégration de la solution, en allant jusqu’à l’animation de la communauté. Par ailleurs, nos plateformes de réemploi sont intuitives, personnalisables et conformes aux normes, pour une utilisation en toute sérénité.
Déjà plus de 16 millions d’euros d’achats évités, avec une rentabilité constatée en moins de trois mois. Qu’attendez-vous pour vous lancer ?
FAQ « Réemploi définition »
Quelle est la définition du réemploi ?
Le réemploi consiste à utiliser un produit, un composant ou un matériau pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu, sans transformation majeure. Il s’agit de prolonger sa durée de vie après un premier usage, en l’utilisant tel quel ou après une légère remise en état si nécessaire.
Quelle est la différence entre le réemploi et le recyclage ?
Le réemploi utilise l’objet avant son passage par la case déchet. Par ailleurs, il est réemployé pour le même usage, sans modification profonde.
Le recyclage implique un statut de déchet, puis une transformation des matériaux pour fabriquer un nouveau produit.
Quelle est la différence entre réemploi et réutilisation ?
Le réemploi consiste à prolonger la durée de vie d’un objet pour le même usage. Une machine industrielle est réemployée telle quel, pour la même utilisation.
La réutilisation implique un usage différent ou modifié, parfois après adaptation. Par exemple, transformer un bidon en pot de fleurs.
Pourquoi faire du réemploi ?
Le réemploi présente de nombreux avantages :
- Environnementaux : réduction des déchets, économie de matières premières, baisse de l’empreinte carbone
- Économiques : réduction des coûts d’achat et de gestion des déchets
- Sociaux : création d’emplois locaux, développement d’activités solidaires
- Réglementaires : réponse aux obligations issues de la loi AGEC et des politiques d’achats durables